Une nouvelle étude de The Conference Board, analysant plus de 250 entreprises, révèle les dix priorités qui façonneront les stratégies de RSE en 2025. Si les évolutions réglementaires occupent le premier rang, les résultats mettent en lumière un contexte marqué par une fragmentation réglementaire conjuguée à une complexité opérationnelle, où la réussite passe par un dépassement de la simple conformité au profit d’une intégration stratégique.
Cet article analyse ces priorités du point de vue des équipes développement durable confrontées aux défis concrets, en intégrant les témoignages de praticiens ayant suivi l’évolution de près.
Les évolutions réglementaires redessinent le paysage de la RSE
Le principal défi auquel seront confrontés les professionnels de la RSE en 2025 consiste à s’adapter à des environnements réglementaires en constante évolution. Les recherches du Conference Board soulignent que les changements de politique constituent la priorité numéro un en matière de développement durable en entreprise, 80 % des responsables RSE ajustant leurs stratégies face à ces mutations réglementaires.
Les changements les plus marquants ont eu lieu aux États-Unis, où la politique fédérale en matière de climat s’est recentrée sur le développement accru des énergies fossiles et la réduction des incitations aux énergies renouvelables. Le retrait par la Securities and Exchange Commission de sa règle fédérale sur le reporting climatique traduit un changement radical des exigences réglementaires, contraignant les entreprises à revoir leurs stratégies de reporting.
Cependant, ce retrait fédéral ne marque pas la fin de la réglementation en matière de développement durable. Les lois SB 253 et SB 261 de Californie imposent des obligations strictes de transparence climatique aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires important dans l’État, générant ainsi un maquis de contraintes juridictionnelles que les équipes RSE doivent savoir gérer.
Les entreprises réagissent par des ajustements pragmatiques : 52 % restreignent ou réorientent leurs communications ESG, tandis que 48 % renforcent les processus d’examen juridique et d’évaluation des risques. De nombreuses organisations remplacent des termes sensibles comme « ESG » par un vocabulaire plus neutre, tel que « développement durable » ou « résilience », afin d’éviter les controverses politiques tout en poursuivant des programmes concrets.

Comme le souligne Christoph Bock de RTL2 Fernsehen dans l’initiative Voices of Sustainability de Plan A :
Si votre entreprise est concernée par les Omnibus Proposals, il peut être utile d’envisager de <em>rester le cap</em>. La crise climatique reste préoccupante. Nous avons donc choisi de maintenir notre engagement à poursuivre notre agenda de développement durable avec détermination.
La réponse stratégique nécessite de concilier la sensibilité politique avec les fondamentaux de l’entreprise. Les sociétés doivent ancrer leurs stratégies de développement durable dans une création de valeur mesurable tout en adaptant leur communication aux attentes changeantes des parties prenantes.
La complexité réglementaire impose des méthodes de reporting sophistiquées
La réglementation sur le reporting ESG continue de s’étendre à l’échelle mondiale, générant une complexité sans précédent pour les multinationales. La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) de l’Union européenne reste en vigueur malgré les révisions en cours via l’initiative Omnibus, qui a reporté l’entrée en vigueur pour les entreprises non européennes de 2028 à 2030.
Les lois californiennes sur la divulgation climatique illustrent la fragmentation du paysage réglementaire. La SB 253 oblige les entreprises réalisant plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires en Californie à déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre de Scope 1 à 3, avec un audit et une assurance réalisés par un tiers, tandis que la SB 261 impose la publication de rapports sur les risques climatiques conformément aux recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Cette divergence réglementaire impose des choix stratégiques aux équipes développement durable. Certaines entreprises optent pour des approches de conformité minimale afin de réduire leur exposition juridique, notamment sur des marchés politiquement instables. D’autres choisissent de s’aligner sur les normes mondiales les plus exigeantes pour renforcer la confiance des investisseurs et fiabiliser à long terme leurs capacités de reporting.
L’approche la plus efficace consiste à traiter les données ESG selon des normes de qualité financière. Cela implique de mettre en place des contrôles internes rigoureux, d’associer les comités d’audit dès les premières étapes, et d’instaurer des systèmes capables de répondre aux exigences d’assurance externe.
Démontrer le retour sur investissement devient essentiel
La pression pour démontrer un retour sur investissement (ROI) mesurable des initiatives de développement durable s’est nettement renforcée. Seuls 9 % des cadres interrogés jugent leur capacité à mesurer le ROI de la RSE bonne ou excellente, tandis que 38 % la considèrent comme médiocre, révélant ainsi une lacune majeure en matière de compétences.
Ce défi lié au retour sur investissement reflète des pressions économiques plus larges. L’inflation, les perturbations des chaînes d’approvisionnement et l’incertitude géopolitique ont renforcé l’attention portée par les dirigeants à l’ensemble des investissements, y compris aux programmes de développement durable. Les conseils d’administration et les dirigeants de haut niveau attendent des preuves solides que les initiatives RSE améliorent l’efficience opérationnelle, atténuent les risques et participent à la création de valeur pérenne.
Les équipes les plus performantes en matière de développement durable commencent par des résultats directs et mesurables. Les programmes d’efficacité énergétique offrent généralement le retour sur investissement le plus évident, avec des entreprises qui réalisent des réductions de coûts de 10 à 30 % grâce à l’optimisation de leur consommation d’énergie. Les initiatives de conservation de l’eau apportent la même clarté, notamment pour les opérations industrielles situées dans des zones en stress hydrique.
L’analyse de McKinsey portant sur plus de 2 200 entreprises révèle que les « triple outperformers », c’est-à-dire les entreprises excellant à la fois en croissance, rentabilité et performance ESG, dégagent un rendement total pour les actionnaires supérieur de 2 points de pourcentage par an par rapport aux entreprises axées uniquement sur la performance financière, et de 7 points de pourcentage par rapport à la moyenne des entreprises.
Élaborer une mesure crédible du ROI nécessite une collaboration transversale. Les équipes RSE doivent travailler en étroite coordination avec les services financiers, les achats responsables, les ressources humaines et les opérations afin de mettre en place des cadres de mesure homogènes et des structures de responsabilité partagée.
La stratégie climat dépasse le simple respect des obligations
La stratégie climat reste une priorité majeure, plus de 80 % des entreprises du S&P 500 reconnaissant désormais publiquement le changement climatique comme un risque pour leurs activités. Toutefois, l’attention s’est déplacée de la simple publication d’informations vers une intégration stratégique au cœur des opérations business.
Les entreprises les plus avancées intègrent les enjeux climatiques dans leurs dispositifs de gestion des risques d’entreprise, leurs processus d’allocation du capital et leurs mécanismes de rémunération des dirigeants. Cette intégration couvre à la fois les risques physiques — événements météorologiques extrêmes, sécheresse, inondations — et les risques de transition liés aux évolutions réglementaires et aux exigences croissantes en matière de reporting.
Les émissions Scope 3 constituent le principal défi stratégique. Ces émissions indirectes, réparties sur l’ensemble des chaînes de valeur, représentent généralement entre 65 % et 75 % de l’empreinte carbone totale d’une entreprise, tout en restant les plus complexes à mesurer et à maîtriser. Pour relever ces défis, les entreprises investissent dans des programmes d’engagement des fournisseurs, des systèmes renforcés de collecte de données, ainsi que dans des initiatives collaboratives au sein de leur secteur.

Comme l’a souligné Nathan Bonnisseau, cofondateur de Plan A :
Disposer d’une plateforme qui vous oriente vers les actions les plus efficaces tout en identifiant les points chauds d’émissions est là où la technologie fait vraiment la différence.
La transparence de la chaîne d’approvisionnement, un levier de différenciation compétitive
La durabilité de la chaîne d’approvisionnement est passée d’une obligation de conformité à un avantage stratégique. Les entreprises reconnaissent que la majorité des impacts environnementaux et sociaux, notamment les émissions de Scope 3, la déforestation et les enjeux liés aux droits humains, se produisent en amont de leur chaîne de valeur.
La pression réglementaire accélère cette transition. La Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) de l’UE ainsi que le règlement sur les produits sans déforestation obligeront de nombreuses entreprises, y compris de grandes multinationales basées aux États-Unis, à identifier, prévenir et traiter les risques environnementaux et liés aux droits humains tout au long de leurs opérations mondiales.
La Uyghur Forced Labor Prevention Act illustre comment des régulations ciblées géographiquement peuvent transformer les pratiques des chaînes d’approvisionnement mondiales. Bien qu’elle se concentre sur la région du Xinjiang en Chine, ses exigences de conformité, telles que la traçabilité de bout en bout, la vérification par un tiers et une diligence raisonnable approfondie des fournisseurs, traduisent des attentes plus larges en matière de transparence des chaînes d’approvisionnement.
Les entreprises adoptent des approches à plusieurs niveaux. Les premières initiatives ciblent les fournisseurs de premier rang, en définissant des attentes claires et en mettant en place des systèmes de suivi. Des programmes avancés étendent ensuite la visibilité aux fournisseurs de deuxième et troisième rangs, où se concentrent de nombreuses activités à haut risque.
Plus de la moitié des entreprises sondées par The Conference Board en mai 2025 ont déclaré accorder une attention renforcée aux droits humains dans leurs chaînes d’approvisionnement, 7 % ayant considérablement intensifié leurs efforts et 45 % les ayant modérément renforcés.
Question : « En 2025, votre organisation a-t-elle modifié son approche des droits humains dans la chaîne d’approvisionnement en raison des évolutions politiques et réglementaires aux États-Unis et en Europe ? »
Répondants : 29 participants au sondage :
Les programmes de durabilité des chaînes d’approvisionnement les plus efficaces associent des solutions technologiques à des initiatives sectorielles collaboratives. Les entreprises investissent dans des systèmes de traçabilité basés sur la blockchain, la surveillance satellitaire des risques de déforestation et des plateformes partagées d’évaluation des fournisseurs afin d’accroître la visibilité tout en réduisant les contraintes individuelles de conformité.
La gestion durable de l’eau cible les risques locaux
La gestion durable de l’eau est devenue une priorité essentielle, notamment pour les entreprises opérant dans des zones soumises à un stress hydrique. Les épisodes de sécheresse prolongée dans le Sud-Ouest des États-Unis, au Texas et dans le bassin du fleuve Colorado ont renforcé les risques physiques et réglementaires auxquels sont confrontées les industries fortement consommatrices d’eau.
Les données sur la consommation d’eau en entreprise révèlent des tendances encourageantes, avec une utilisation médiane des entreprises du S&P 500 passant de 2,4 millions de mètres cubes en 2022 à 1,7 million de mètres cubes en 2024. Cette baisse traduit à la fois des gains d’efficience et une gestion stratégique des risques.
Les stratégies liées à l’eau se localisent de plus en plus. Les entreprises réalisent des évaluations au niveau des bassins hydrographiques pour mieux comprendre la disponibilité régionale de l’eau et fixent des objectifs basés sur la science, adaptés aux niveaux de stress hydrique locaux. Les technologies avancées de recyclage et les systèmes d’irrigation de précision permettent de réduire la consommation tout en maintenant l’efficacité opérationnelle.
.avif)
La collaboration avec les acteurs locaux est essentielle pour assurer une gestion durable de l’eau. Les entreprises s’associent aux autorités municipales, aux organisations agricoles et aux associations environnementales pour élaborer des stratégies communes de gestion de l’eau, garantissant ainsi la continuité opérationnelle à long terme tout en répondant aux besoins des communautés.
La biodiversité s'impose comme une priorité stratégique
La biodiversité s’impose de plus en plus comme une priorité en matière de RSE, avec 59 % des entreprises du S&P 500 disposant désormais de politiques dédiées à la biodiversité, contre 29 % en 2021. Cette progression traduit une prise de conscience accrue du rôle essentiel des écosystèmes naturels dans la sécurité alimentaire, la disponibilité de l’eau, la stabilité climatique et la résilience économique.
Le cadre de la Task Force on Nature-Related Financial Disclosures (TNFD) favorise une évaluation systématique des risques et opportunités liés à la nature. Les entreprises des secteurs agricole, extractif ainsi que de l’alimentation et des boissons sont particulièrement mises sous pression en raison de leur dépendance aux écosystèmes naturels et des impacts potentiels sur la biodiversité.
Les défis de mise en œuvre sont majeurs. Les impacts sur la biodiversité sont très spécifiques à chaque lieu et difficiles à mesurer de manière homogène, ce qui complique l’établissement des objectifs et les processus de reporting. Les entreprises aux chaînes d’approvisionnement complexes rencontrent des difficultés supplémentaires pour évaluer et gérer les risques liés à la biodiversité à travers diverses zones géographiques et types d’écosystèmes.
Les stratégies de biodiversité les plus efficaces se concentrent sur les enjeux clés en lien direct avec les activités de l’entreprise. Les entreprises du secteur agroalimentaire s’attaquent au déclin des pollinisateurs et à la santé des sols grâce à des pratiques d’agriculture régénérative. Celles des secteurs extractifs et des infrastructures privilégient la planification de l’usage des sols et la restauration des habitats. Les entreprises de biens de consommation mettent l’accent sur les achats responsables et les matériaux d’emballage durables.
Les investissements dans les systèmes de traçabilité, le suivi géospatial et les partenariats locaux soutiennent ces initiatives. Les entreprises exploitent l’imagerie satellite, la technologie blockchain et la vérification terrain pour renforcer la visibilité des impacts sur la biodiversité tout au long de leurs chaînes de valeur.
L’intégration au cœur de l’entreprise accélère l’impact en matière de développement durable
L’intégration de la RSE au cœur des fonctions métier constitue une transformation majeure, passant de programmes isolés à des pratiques opérationnelles pleinement ancrées. Les données d’enquête mettent en lumière des avancées inégales selon les départements, les services juridiques, les achats responsables, les opérations et la communication affichant les niveaux d’intégration les plus élevés.
La finance et les ressources humaines accusent un retard important dans l’intégration de la RSE. Seules 12 % des entreprises déclarent une intégration poussée dans ces fonctions, malgré leur rôle crucial dans l’allocation des capitaux, le développement des talents et la planification stratégique à long terme. Ce décalage freine l’efficacité des initiatives de développement durable et en réduit l’impact commercial potentiel.
De nombreuses entreprises adoptent des modèles hybrides de type « hub-and-spoke » pour relever les défis liés à l’intégration. Une équipe centrale dédiée à la RSE définit la stratégie, pilote le reporting et mène les relations externes, tandis que les unités opérationnelles prennent en charge la mise en œuvre dans leurs domaines respectifs.
Une intégration réussie nécessite des structures de responsabilité clairement définies et des incitations à la performance. Les entreprises intègrent désormais des indicateurs RSE dans la rémunération des dirigeants, les objectifs des départements et les critères d’évaluation des projets afin d’encourager un comportement cohérent à l’échelle de l’organisation.
Comme le souligne Dany Leroux, Responsable du développement durable chez L'Oréal Italia :
Les responsables du développement durable ne doivent pas être les seuls à porter la transition sociale et écologique au sein de leur entreprise. Ils doivent au contraire déléguer et répartir ces responsabilités entre toutes les équipes impliquées dans ces enjeux.
Le storytelling RSE renforce l’engagement des parties prenantes
Raconter efficacement la RSE est devenu indispensable pour mobiliser des parties prenantes variées et faire progresser les objectifs de développement durable de l’entreprise. Si les exigences réglementaires imposent un reporting ESG cohérent, les entreprises reconnaissent de plus en plus la valeur stratégique de récits percutants qui dépassent le simple respect des obligations.
Les données d’enquête révèlent que 37 % des entreprises américaines et 36 % des entreprises européennes s’appuient encore sur des rapports traditionnels, très axés sur les données, avec peu de mise en récit. Toutefois, beaucoup expérimentent des approches plus créatives, telles que les formats interactifs, le storytelling visuel et des contenus adaptés à des publics spécifiques.

Les récits de développement durable les plus impactants combinent des données d’audit fiables avec des exemples concrets. Les entreprises mettent en avant leurs collaborateurs, leurs communautés et leurs partenaires pour rendre les actions de RSE plus tangibles et parlantes. Cette démarche favorise l’intégration profonde du développement durable dans la culture d’entreprise tout en permettant aux marques de se démarquer dans des marchés concurrentiels.
Les messages doivent être adaptés aux différents groupes de parties prenantes. Les investisseurs et les régulateurs accordent la priorité à la matérialité et aux résultats mesurables, tandis que les employés et les clients sont davantage sensibles à la raison d’être, à l’impact et à l’authenticité. Les entreprises performantes élaborent des stratégies de contenu qui prennent en compte ces attentes variées tout en conservant des messages clés cohérents.
Les plateformes technologiques offrent des approches narratives plus sophistiquées. Les tableaux de bord interactifs, les expériences en réalité virtuelle et les applications en réalité augmentée permettent aux parties prenantes d’interagir avec les données RSE de manière immersive, bien au-delà des possibilités offertes par les rapports traditionnels.
L’intelligence artificielle offre des opportunités et comporte des risques
L’IA s’impose à la fois comme un levier pour la RSE et comme un défi pour le développement durable. Les entreprises perçoivent des opportunités pour exploiter l’IA dans la prévision des émissions, l’optimisation énergétique et l’identification des risques dans la chaîne d’approvisionnement, tout en faisant face aux risques environnementaux et sociaux liés à son déploiement.
Les données de l’enquête révèlent des avis partagés quant à l’impact de l’IA sur la durabilité. 54 % des entreprises y voient des opportunités environnementales, tandis que 34 % en détectent des risques. Sur le plan social, la perception est encore plus nuancée, avec 57 % d’opportunités identifiées contre 53 % de risques.

Les premières applications se concentrent sur le reporting RSE et la gestion des données. L’IA générative peut faciliter la rédaction des déclarations en synthétisant de grands volumes de données, en adaptant le langage aux cadres de reporting, et en produisant un contenu personnalisé selon les différents publics. Ces solutions réduisent le travail manuel tout en améliorant la cohérence et la précision.
Les applications avancées d’IA offrent une valeur stratégique renforcée. Les algorithmes d’apprentissage automatique peuvent anticiper les risques climatiques, optimiser les profils de consommation énergétique et détecter les vulnérabilités dans la chaîne d’approvisionnement avant qu’elles ne deviennent des problèmes critiques. Cependant, ces solutions nécessitent des infrastructures de données sophistiquées ainsi que des capacités analytiques avancées.
Les coûts environnementaux liés au déploiement de l’IA sont importants. La formation et le fonctionnement des grands modèles de langage mobilisent des ressources énergétiques et hydriques considérables, ce qui pose un problème particulier dans les régions où la disponibilité en énergies renouvelables est limitée. Les entreprises doivent trouver un équilibre entre les bénéfices de l’IA et ses impacts environnementaux.
Les priorités RSE pour 2025 témoignent d’une maturité accrue du domaine, les entreprises dépassant la simple conformité pour intégrer la durabilité de manière stratégique, générant ainsi une valeur commerciale mesurable. La réussite passe par un équilibre entre les exigences réglementaires et les attentes des parties prenantes, tout en démontrant un retour sur investissement clair.
Comme le souligne Irina Bolgari, responsable du développement durable chez La Prairie Switzerland :
Rester agile – aucun jour ne se ressemble dans la vie d’un responsable du développement durable. Ce qui me motive, c’est de me demander : « Dans les circonstances actuelles, quel est l’axe prioritaire sur lequel je peux agir pour générer le plus d’impact ? »
Les entreprises qui réussiront dans ce contexte sont celles qui intègrent la RSE au cœur de leurs opérations, exploitent la technologie pour optimiser l’efficience et la compréhension, tout en gardant un cap clair sur des résultats mesurables. Plan A offre une plateforme complète et un accompagnement expert indispensables pour gérer efficacement ces priorités, aidant ainsi les entreprises à transformer la durabilité d’une simple contrainte réglementaire en un véritable avantage stratégique.
Prêt à renforcer votre stratégie de développement durable pour 2025 ? Réservez une démo avec les experts en RSE de Plan A pour découvrir comment notre plateforme peut vous aider à relever ces enjeux majeurs tout en générant un impact business mesurable.



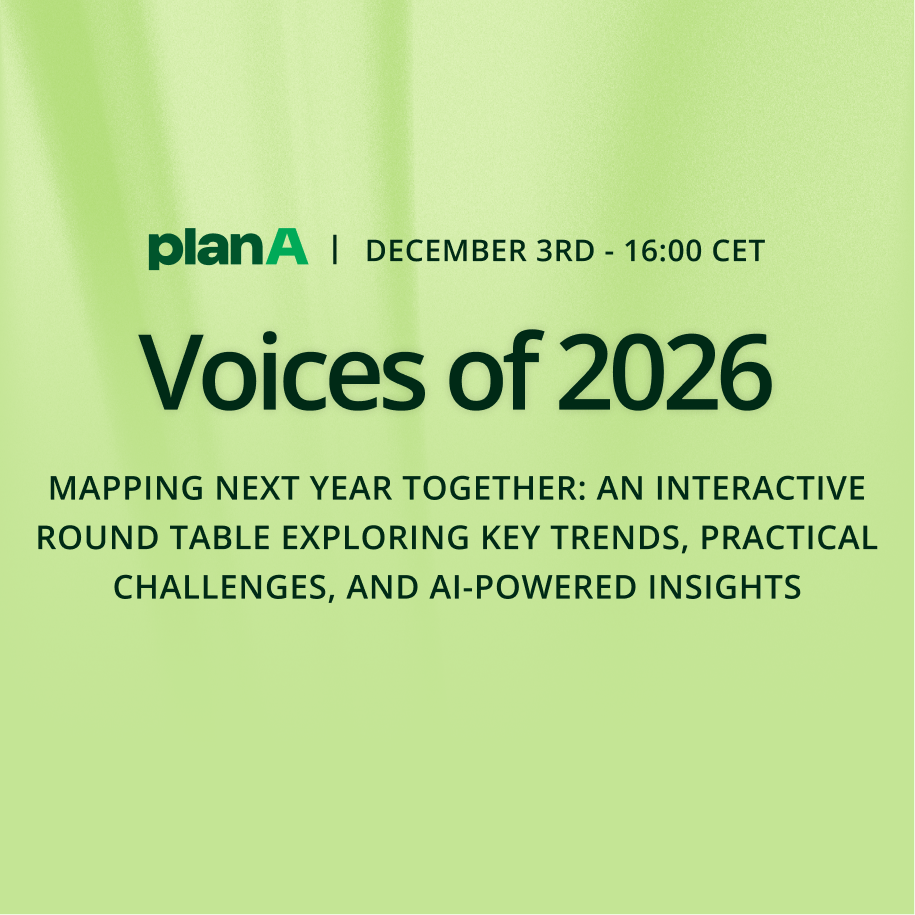
.jpg)

%20(1).jpg)
